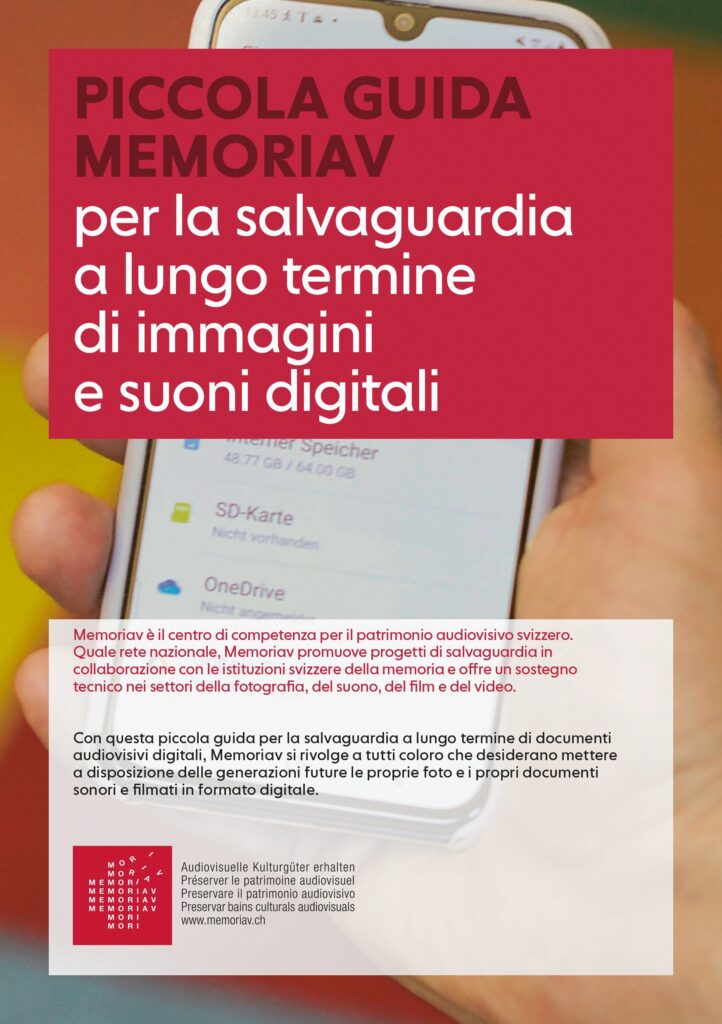Das Osservatorio culturale del Cantone Ticino organisiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Locarno am 8. August im Corte di Casa Rusca in Locarno eine Diskussionsmatinee zum Thema «Audiovisuelles Erbe». Im Mittelpunkt steht die Rolle lokaler Behörden, Institutionen sowie öffentlicher und privater Akteure bei der Bewahrung und Aufwertung dieses Erbes. Auch Cécile Vilas, Direktorin von Memoriav, wird aktiv an der Veranstaltung teilnehmen und sich in die Diskussion einbringen.
Die Diskussion wird mit zwei informativen Beiträgen eröffnet, die die heute bereits verfügbaren Möglichkeiten und Instrumente präsentieren. Im Anschluss findet ein Podiumsgespräch statt, in dem Kommunalarchive, Rundfunkarchive und Verbände ihre Erfahrungen austauschen, um über Gegenwart und Zukunft des audiovisuellen Erbes zu diskutieren. Ziel ist es, eine Reihe von Fragen zu erörtern, die für dieses Kulturgut von Bedeutung sind. Wie steht es heute um das lokale audiovisuelle Erbe? Welchen Bedarf gibt es in Bezug auf Erhaltung, Digitalisierung und Zugang? Wo sollten wir ansetzen, um ein entsprechendes Projekt zu initiieren? Zum Programm

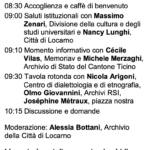
Memoriav, in collaborazione con la Commissione svizzera per l’UNESCO, lancia un invito a tutte le istituzioni svizzere che conservano o lavorano con il patrimonio audiovisivo (fotografie, film, video, registrazioni sonore) a partecipare alla Giornata mondiale del patrimonio audiovisivo, che si celebrerà il 27 ottobre 2025.
È un’occasione unica per:
– Valorizzare la vostra istituzione e le vostre collezioni davanti a un vasto pubblico
– Far conoscere le vostre attività di conservazione, ricerca e valorizzazione
– Sensibilizzare all’importanza della memoria audiovisiva come patrimonio collettivo
– Partecipare a un evento festoso e collaborativo a livello nazionale
Memoriav vi accompagna per garantire la visibilità nazionale del vostro evento:
– Promozione sul nostro sito web (newsletter, social media)
– Campagna di comunicazione (poster A2, flyer A5)
Come partecipare?
Organizzate un’attività legata alle vostre collezioni audiovisive tra il 20 ottobre e il 2 novembre 2025: proiezioni, mostre, laboratori, visite guidate, eventi online… Date vita ai vostri archivi!
Potete ispirarvi alle iniziative degli anni passati o proporre un formato originale!
Inviate i vostri progetti entro il 25 agosto 2025 a communication@memoriav.ch:
– Nome dell’istituzione
– Data e luogo dell’evento
– Descrizione breve (+ link del sito web se disponibile)
– Descrizione completa (facoltativa)
– Illustrazioni per il web (foto, locandina, materiale visivo)

Que conserver, numériser et cataloguer à long terme ? Qui s’en charge ?Comment les petites institutions peuvent-elles effectuer une sélection de documents audiovisuels qu’elles seront en mesure de gérer ? Comment les acteurs de la politique culturelle garantissent-ils que la diversité sociale et culturelle de la Suisse soit représentée ? Ces questions et bien d’autres concernant les stratégies en matière de collections figurent au programme de la Journée professionnelle 2025 de Memoriav. De passionnants exposés et des ateliers interactifs vous attendent. Inscrivez-vous dès maintenant!
Le recensement du patrimoine audiovisuel mené par Memoriav montre de manière frappante le nombre de collections de photos, films, vidéos, documents sonores et diaporamas existant en Suisse. Non seulement des institutions culturelles telles que les musées, les archives et les bibliothèques possèdent des fonds audiovisuels, mais nombre d’entre eux se trouvent dans des collections privées, des associations, des paroisses, etc. Des stratégies en matière de collections sont nécessaires afin de conserver et rendre accessibles ces fonds audiovisuels à long terme.
Informations pratiques – Journée Professionnelle Memoriav 2025
- Titre:
Entre collectionnite aiguë et arrêt de la collecte - Date:
25.06.2025 - Lieu:
Uni vonRoll, Fabrikstrasse 6, Berne – avec le bus no 20 jusqu’au terminus “Länggasse”.
Vers le plan d’accès - En ligne : La matinée du colloque sera également retransmise en ligne, mais sans traduction.
- Programme:
Programme provisoire de la journée (PDF) - Prix :
– Membres : CHF 230
– Non-membres : CHF 350
– Étudiants : CHF 50
– Participation en ligne (uniquement le matin, sans traduction) : CHF 120.-
Le lien pour la participation en ligne vous sera envoyé par mail peu avant l’événement. - Traductions
Traduction simultanée (ALL / FR et FR / ALL) - Partenaires:
La journée se déroule en collaboration avec le programme de formation continue en archivistique, bibliothéconomie et sciences de l’information des Universités de Berne et de Lausanne (CAS/MAS ALIS). Nous avons également comme partenaires: - – CECO
– Bibliosuisse
– Association des archivistes suisses (AAS)
– Association des musées suisses (AMS – ICOM Suisse).

Formulaire d’inscription en ligne
Journée professionnelle Memoriav 2025
La date limite d’inscription est dépassée.
Le Musée national suisse à Zurich présente une exposition rétrospective sur les 100 ans d’activité de la plus vieille maison de production suisse: la Praesenz et passe en revue l’histoire de certains des classiques du cinéma suisse sauvegardés avec le soutien de Memoriav.
La plus ancienne société cinématographique de Suisse encore en activité possède une riche histoire dont les ramifications s’étendent jusqu’à Hollywood. Fondée par l’immigrant juif Lazar Wechsler, Praesens-Film connut ses heures de gloire entre les années 1930 et le milieu des années 1950, produisant plusieurs des incontournables du cinéma suisse. «Le fusilier Wipf», «Gilberte de Courgenay» et «Heidi» en sont également le fruit, sans oublier les films «Marie-Louise» et «La dernière Chance», tous deux récompensés à l’international.
L’exposition braque les projecteurs sur les personnes qui, par leur travail devant comme derrière la caméra, ont contribué à écrire l’histoire du cinéma suisse. Elle livre des anecdotes sur la genèse des films et illustre la manière dont le grand écran reflète l’époque, la politique et la société dans lesquelles il s’inscrit. Elle passe en revue l’essor de l’industrie du septième art, marqué par les premières productions publicitaires et de commande, mais aussi les longs-métrages réalisés pendant la guerre, empreints du mouvement de défense spirituelle et de la tradition humanitaire, sans oublier l’idéalisation de la patrie dans le cinéma d’après-guerre.

Début 2024, la plus ancienne société de production de Suisse: Praesens-Film AG fête ses 100 ans d’existence. Profitez de redécouvrir sur grand-écran, au filmpodium de Zurich et lors des Journées de Soleure, 12 films qui ont été sauvegardés avec le soutien de Memoriav dont «The Village», projeté pour la première fois à Cannes dans les années 1950 et dont la version numérique sera présentée en première suisse les 22 et 25 janvier prochains.
Dans le cadre des célébrations le filmpodium à Zurich vous propose de découvrir les films suivants ayants fait l’objet d’une sauvegarde Memoriav :
– 18. et 29.01.2024 – Füsilier Wipf de Leopold Lindtberg, Hermann Haller (Schweiz 1938)
– 4. et 19.01.2024 ainsi que 14.02.2024 – Wilder Urlaub de Franz Schnyder (Schweiz 1943)
– 10.et 21.01.2024 ainsi que 12.02.2024 – Marie-Louise de Leopold Lindtberg (Schweiz 1944)
– 2. et 10.01.2024 ainsi 22.01.2024 – Die letzte Chance de Leopold Lindtberg (Schweiz 1945)
– 25.01.2024 et 9.ainsi que 14.02.2024 – The Village de Leopold Lindtberg (Schweiz/GB 1953)
– 05.01.2024 et 01.02.2024 – Uli der Knecht de Franz Schnyder (Schweiz 1954)
– 12.01.2024 et 07.02.2024 – Uli der Pächter de Franz Schnyder (Schweiz 1955)
Les Journées de Soleure vous proposent de redécouvrir les films Praesens suivants, ayant bénéficié d’une sauvegarde Memoriav:
– 19.01.2023 – Mein Persienflug de Walter Mittelholzer
– 21.01.2023 – Swiss Tour de Léopold Lindtberg
– 22.01.2023 – The Village de Léopold Lindtberg

Memoriav pubblica un’altra piccola guida rivolta ai privati sul trattamento dei dati digitali.
Ormai da svariati anni le foto, le registrazioni audio e i video vengono effettuati per lo più con fotocamere digitali o telefoni cellulari e archiviati in formato digitale. Allo stesso tempo
è cresciuto il bisogno di digitalizzare le stampe fotografiche, i nastri sonori e i filmati privati disponibili nel formato Super8 o nelle videocassette di un tempo e di salvaguardare questo materiale per le generazioni successive. Purtroppo, le immagini e i suoni digitali non vengono archiviati a lungo termine in modo automatico. I supporti di archiviazione si danneggiano o non possono più essere letti dai nuovi computer. Lo stesso vale per i formati di file che non possono più essere riprodotti dai sistemi operativi più recenti. Inoltre, considerando che il numero di file digitali è in continuo aumento, si corre il rischio di perdere il controllo della situazione. Questa guida mostra come si può ridurre il rischio di perdere dati, fornendo consigli su formati, supporti di archiviazione, strutturazione, controllo e migrazione dei file. In questa guida trovate anche informazioni sulla sicurezza dei dati. Non buttate via l’originale fisico dopo la digitalizzazione!
Scoprite la Piccola Guida Memoriav per la salvaguardia a lungo termine di immagini e suoni digitali in formato PDF – download.
La guida pratica alle funzioni principali del software QuickHash-GUI, annunciata nella guida. Disponibile online qui (PDF).
Fornitori di servizi
Se vuoi utilizzare un esperto o uno specialista per il restauro e/o la digitalizzazione dei tuoi documenti sonori, forniamo qui una lista di fornitori di servizi:Fornitori di servizi
Raccomandazioni per il personale delle istituzioni della memoria
La Piccola Guida per la salvaguardia a lungo termine di immagini e suoni digitali di Memoriav è destinata al grande pubblico. Raccomandazioni dettagliate per il personale delle istituzioni della memoria responsabili delle collezioni e del patrimonio audiovisivo si possono trovare sul nostro sito web: raccomandazioni in lingua tedesca o francese
La Piccola Guida come volantino pratico
La Piccola Guida può essere scaricata in formato PDF in tedesco, francese e Iitaliano o ordinata come volantino su info@memoriav.ch.
Restauré par la Cinémathèque suisse en collaboration avec la SRF et avec le soutien de Memoriav, le long métrage The Village, réalisé par Leopold Lindtberg (1953), a été sélectionné pour la 76e édition du Festival de Cannes. Septante ans après sa première projection sur la Croisette, le film sera présenté dans la section « Cannes Classics ».
The Village (Le Village près du ciel) est le douzième long métrage de fiction du cinéaste suisse Leopold Lindtberg, réalisé en 1953. Fiction helvético-britannique, The Village est un drame porté par l’idée de paix entre les nations et raconte les destins de plusieurs orphelins de guerre venus de toute l’Europe, réunis dans un village des alpes en Suisse à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Dernier long métrage de fiction que Leopold Lindtberg réalise pour Praesens Films, The Village est une œuvre polyglotte, à l’instar d’autres collaborations entre le cinéaste et la maison de production zurichoise (Die letzte Chance, Die Vier im Jeep…) ; les interprètes proviennent de dix pays différents et le tournage, principalement en langue anglaise et allemande, inclut également des scènes en français, polonais et italien. Tourné en Suisse et en Angleterre, le film sera largement distribué sur le marché international, anglo-saxon en particulier, et remportera de nombreuses distinctions dont l’Ours de Bronze au Festival de Berlin, en juin 1953, ainsi que le Laurier d’argent du Prix David O. Selznick.
Restauration du film
Le film a connu plusieurs montages différents, notamment pour les marchés allemand et autrichien, et distribués sous des titres très variés. Il existe également une version suisse intitulée Unser Dorf. La nouvelle restauration proposée à Cannes s’est concentrée sur la version internationale du film, intitulée The Village, la plus soignée d’un point de vue technique et qui avait été projetée sur la Croisette en 1953.
La Cinémathèque suisse, en collaboration avec la SRF et avec le soutien de Memoriav, a fait appel aux laboratoires zurichois Cinegrell et Tonstudio Z. La restauration 4K de la version originale internationale du film a été effectuée à partir des négatifs image et son originaux, déposés à la Cinémathèque suisse par la société de production Praesens-Films AG. Elle sera proposée dans la la section « Cannes Classics », en présence de Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse et Ariane Baudat, restauratrice du film. En 2024, Praesens Films fêtera son 100e anniversaire avec une exposition au Musée national suisse, des publications et de nombreuses projections, en festivals, des chef-d’œuvres aujourd’hui restaurés et qui lui ont valu plusieurs Oscars.
Le film sera projeté le 25 mai 2023 à 14h30, en savoir plus

Le projet de recensement audiovisuel conduit par Memoriav s’étend aujourd’hui à l’ensemble de la Suisse avec différents stades d’avancement.
Dans les cantons du Valais, d’Argovie et dans les deux Appenzell le recensement cantonal est terminé. Il est en cours dans les cantons de St-Gall, de Schwytz et du Jura. Des négociations et des contacts ont été tissés avec le reste des cantons comme le montre la carte ci-contre.
Vous pouvez suivre l’état d’avancement détaillé dans les cantons sous le lien suivant

|

Les jeux vidéo suisses font-ils partie de notre patrimoine audiovisuel? Quelles seraient les mesures à mettre en œuvre pour en assurer la sauvegarde? Memoriav, le pôle de compétence pour le patrimoine audiovisuel suisse, souhaite répondre à ces questions en 2021 et lance pour cela une étude sur le sujet.
Les jeux vidéo sont une composante majeure, car très populaire, de notre monde culturel numérique contemporain. Leur importance patrimoniale reste toutefois mal évaluée. Leur impact économique est certes conséquent au siècle passé déjà, mais leur dimension culturelle ne dispose encore que de peu de légitimité. Pourtant, depuis plus de quarante ans, les jeux vidéo ont été un vecteur fort du développement de notre habileté numérique. Si l’expérience tirée des jeux vidéo est partout, qu’il s’agisse de l’élaboration de bornes de vente de tickets de bus ou de celle de nos environnements de télétravail, ils ne disposent vraisemblablement pas aujourd’hui de la reconnaissance qui leur est due.
En Suisse, si la production des jeux vidéo a récemment été reconnue pour son importance économique et artistique, les jeux vidéo, en eux-mêmes, n’ont jusqu’ici fait l’objet que de peu de projets d’inventaire, de collecte et de sauvegarde systématique par des institutions patrimoniales.
On connaît en effet le rôle pionnier de la Suisse dans l’histoire de l’informatique (par exemple au travers de l’invention de la souris à microprocesseur) mais on ignore souvent qu’il existe des auteur*e*s et des entreprises helvétiques produisant des jeux vidéo de qualité et des cursus de formation dans le domaine. Ce patrimoine n’a, jusqu’à ce jour, fait l’objet d’aucun programme de sauvegarde alors que les défis pour en garantir la préservation ne sont pas minces.
Memoriav a décidé, cette année, de faire le point sur la question et de détailler les enjeux et les défis liés à la préservation de ces œuvres. Elle est très heureuse d’avoir trouvé dans le GameLab UNIL-EPFL (Groupe d’étude sur le jeu vidéo de l’Université de Lausanne et de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne), le Musée Bolo et l’Atelier 40a des partenaires compétents pour mener cette étude. Vers la page du projet
Le résultat de ces travaux fera l’objet de deux workshops: les 7 juin 2021 et 25 octobre 2021 et d’une publication en 2022. Memoriav évaluera à la lumière de ceux-ci, si elle peut soutenir des projets de sauvegarde futurs dans le domaine du jeu vidéo.
Partenaires du projet
Memoriav est le pôle de compétence et le réseau national de la sauvegarde du patrimoine audiovisuel suisse. Il soutient des projets institutionnels de préservation et propose un accompagnement professionnel dans les domaines de la photographie, du son, du film et de la vidéo.
Le GameLab UNIL-EPFL est un groupe d’étude sur le jeu vidéo et regroupement interdisciplinaire de chercheur·se·s de l’Université de Lausanne (UNIL) et de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) travaillant autour des questions liées au jeu, plus particulièrement au jeu vidéo.
Le Musée Bolo est le musée suisse de l’informatique, de la culture numérique et du jeu vidéo basé à Lausanne. Il a pour objectif la collecte, l’archivage, la préservation, l’inventaire, l’ouverture et l’accessibilité du patrimoine informatique, vidéoludique et numérique suisse. Il est géré par les bénévoles de la fondation Mémoires Informatiques et de l’association Les Amis du Musée Bolo. Sa collection, l’une des plus grandes d’Europe, comporte plus de 5’000 ordinateurs et consoles de jeu, 8’000 logiciels et 15’000 livres et magazines.
l’Atelier 40a est un collectif de conservateurs-restaurateurs fondé à Berne en 2018, qui est spécialisé dans divers domaines: architecture, peinture et sculpture, ainsi que l’art contemporain et les médias. Concernant le présent projet, les compétences principales de l’Atelier 40a sont la préservation et l’archivage des médias numériques et audiovisuels.
Exemples de jeux vidéo suisses emblématiques en Suisse:
Bact édité par Epsitec (Belmont-sur-Lausanne) vers 1981 pour l’ordinateur personnel Smaky 6.
FAR: Lone Sails, développé par Okomotive (Zürich) et édité par Mixtvision en 2018 sur tous les supports récents. Plus d’infos
Farming Simulator, développé par GIANTS Software (Zürich) et édité par Focus Home Interactive de 2008 à nos jours. Plus d’infos
Speedy Blupi, développé et édité par Epsitec (Belmont-sur-Lausanne) en 1998 pour Windows. Plus d’infos
Traps’n’ Treasures conçu par le développeur suisse Roman Werner (Nightingale Productions), édité par Starbyte Software et Krisalis Software en 1993 pour l’ordinateur personnel Amiga. Plus d’infos
When We Disappear développé par Studio Inlusio Interactive (Zürich) en partenariat avec Institut für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen de la Haute école pédagogique du canton de Lucerne, avec le soutien de la Gebert Rüf Stiftung. Sortie prévue en 2022. Plus d’infos
Pour en découvrir d’autres, voir en ligne la liste du Swiss Games Showcase
Contact
Pour l’étude
En français: Yannick Rochat (GameLab UNIL-EPFL) : yannick.rochat@epfl.ch
En allemand: Eléonore Bernard (Atelier 40a) : eleonore.bernard@atelier40a.ch
En italien: Lucas Taddei (Musée Bolo) : lucas.taddei@museebolo.ch
Pour Memoriav
Baptiste de Coulon, Responsable du domaine Video/TV chez Memoriav.
Tél: +41 (0)31 380 10 87. baptiste.decoulon@memoriav.ch